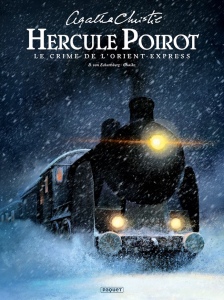C’est le rendez-vous annuel du cinéma français, selon l’expression consacrée. Un cinéma qui, du goût de certains, n’est pas représenté dans son intégralité et dans toute sa diversité, mais un cinéma quand même. Qui se regarde un peu trop le nombril parfois, qui se prend un peu trop au sérieux de temps en temps. Un cinéma qui, ce n’est que mon avis, n’a bien souvent rien à envier à son homologue hollywoodien, comme quoi les petits budgets feraient les grands films. Il ne faudrait tout de même pas confondre cinéma français et Césars du cinéma français.
Bien que j’apprécie cette cérémonie et son côté rassembleur d’une certaine génération d’artistes, mon point de vue est chaque année quelque peu mitigé. Question de goûts et de couleurs peut-être. Si l’académie se fait forte de vouloir récompenser également les comédies et films plus « grand public » et que cela se ressent régulièrement dans sa sélection, les résultats ne suivent souvent pas. L’année dernière, c’est le pourtant joyeux et très réussi Sens de la fête du duo Toledano-Nakache qui était reparti bredouille malgré ses nombreuses nominations. Cette fois-ci, la déception prend les traits du magnifique Grand Bain de Gilles Lellouche. Beaucoup avaient placé espoir en ce film qui, il est vrai, était bien plus qu’une simple comédie, plus profond, plus sensible, plébiscité à la fois par le public et la critique. Certains pronostics le voyaient donc tout naturellement obtenir le César du meilleur réalisateur, voire du meilleur film, qui sait ? Il n’en fût rien. Sur 10 chances de gagner, rien qu’un prix remporté. Seul Philippe Katerine sût tirer son épingle du jeu et décrocher, méritant, le meilleur second rôle. Et ça en valait la peine. Un discours à son image ainsi qu’à celle de Thierry, son personnage dans le film, drôle, touchant et un peu fou.
Pour contrer les critiques réclamant plus de diversité et de comédies aux Césars, l’académie a donc créé depuis l’année dernière le César du public, qui récompense le film ayant attiré le plus de spectateurs en salles. La popularité n’est certes pas un gage de qualité concernant une œuvre, cependant ce nouveau prix traduit bien la volonté des votants de contenter le grand public à moindres frais. Cette année, c’est donc sans surprise Les Tuche 3 d’Olivier Baroux qui eut droit à la distinction. Jolie coïncidence, c’est justement Kad Merad qui était maître de cérémonie, permettant ainsi les retrouvailles entre les deux anciens du duo Kad et Olivier.
Force est de constater que le palmarès global des Césars 2019 fait la part belle aux drames sociaux. Dans le très réussi Les Chatouilles, réalisé par Éric Métayer et Andréa Bescond et (très) largement inspiré de l’histoire de cette dernière, on assiste à la reconstruction par la danse d’une jeune femme abusée sexuellement durant son enfance par un ami de la famille. Le film obtient le César de la meilleure adaptation, ainsi que celui de la meilleure actrice dans un second rôle pour Karin Viard, détestablement parfaite dans son interprétation d’une mère ne voulant rien voir des souffrances de sa fille.

Jusqu’à la garde, de Xavier Legrand, raconte quant à lui l’histoire de Myriam, battue par son mari, qui décide de partir et de traduire celui-ci en justice afin de cesser son emprise sur elle et leurs enfants. Léa Drucker, magistrale, remporte pour ce rôle difficile et douloureux le César de la meilleure actrice, tandis que Denis Ménochet, lui, reste bredouille malgré une performance inquiétante qui composait l’un des piliers du film. Quant à Xavier Legrand, si certains s’étonnaient de ne pas le voir remporter le César du meilleur premier, c’est tout simplement qu’il a fait mieux ! Dépassant des réalisateurs aguerris tels que Jacques Audiard, il entre dans le cercle très fermé de ceux qui ont obtenu un César du meilleur film dès leur première réalisation.

En bref
- César du meilleur acteur : Alex Lutz pour son époustouflante transformation en Guy, ce chanteur à succès des années 60-70, devenu ringard et quelque peu paumé par le monde d’aujourd’hui.

- César du meilleur scénario original : Xavier Legrand pour Jusqu’à la garde.
- César du meilleur espoir masculin : Dylan Robert pour Shéhérazade.
- César du meilleur espoir féminin : Kenza Fortas pour Shéhérazade. Carton plein pour les deux jeunes interprètes de cette chronique marseillaise, choisis par le réalisateur Jean-Bernard Marlin qui ne désirait pas d’acteurs professionnels.
- César du meilleur réalisateur : Jacques Audiard (et de trois !) pour Les frères Sisters.
- César du meilleur premier film : Shéhérazade de Jean-Bernard Marlin.
- César du meilleur film étranger : Une affaire de famille de Hirokazu Kore-eda. Petite déception de ne pas voir Girl de Lukas Dhont sacré.
- César du meilleur film documentaire : Ni juge, ni soumise d’Yves Hinant, Bertrand Faivre et Jean Libon. Je vous le recommande très vivement, pour son côté voyeuriste sans être malsain, ainsi que pour le franc-parler et la gouaille de la juge Anne Gruwez.
- César de la meilleure photographie : Benoît Debie pour Les frères Sisters.
- César du meilleur son : Cyril Holtz, Brigitte Taillandier et Valérie Deloof pour Les frères Sisters.
- César de la meilleure musique originale : Romain Greffe, Vincent Blanchard pour Guy.
- César du meilleur montage : Yorgos Lamprinos pour Jusqu’à la garde.
- César des meilleurs décors : Michel Barthélémy pour Les frères Sisters.
- César des meilleurs costumes : Pierre-Jean Larroque pour Mademoiselle de Joncquières.
…
Meilleurs moments
Malgré un Kad Merad pas très fin ni subtil en maître de cérémonie, la soirée a tout de même été ponctuée de quelques bons moments. Le meilleur d’entre eux restera sans doute l’arrivée de Laurent Lafitte, venu remettre le César du meilleur premier film, et qui a déclenché l’hilarité de la salle ainsi que la perplexité des internautes. En effet, son maquillage plus vrai que nature donnait l’effet de chirurgie esthétique pour le moins abusive.
Cette soirée fût aussi celle des hommages avec celui bien entendu destiné à Michel Legrand, qui aurait toutefois pu être un peu plus marquant compte tenu de l’envergure de l’artiste, mais aussi avec celui, vibrant, consacré par Eddy de Pretto à Charles Aznavour.
Et l’on ne peut évidemment pas parler d’une cérémonie des Césars sans parler du César d’honneur. Cette année, c’est le mythique Robert Redford qui était célébré salle Pleyel, ne manquant pas de rappeler dans son discours combien la France lui tient à cœur en tant qu’artiste.

En espérant que cet article vous a plu, à l’année prochaine pour une autre cérémonie des Césars 🎭